Reclusiennes (Les –)
Universitaires et activistes autour de pensées questionnant ces systèmes qui font nos mondes
Fidèles à la tradition d’éducation populaire dans laquelle elles s’inscrivent, Les Reclusiennes font cohabiter contributions savantes et expériences du quotidien pour favoriser un échange toujours souhaité entre les différents auditoires et interventions à la tribune. Chaque festival de la pensée autour des idées du géographe libertaire Élisée Reclus nous invite à philosopher sur la liberté et le déterminisme, sur la question morale des trajectoires et du vivre ensemble (en lien avec le genre, la finance, l’habitat, les dépendances alimentaires, les projets de vies…).

Les Reclusiennes ? un nouveau format de festival qui rassemble chercheurs, militants, écrivains, philosophes, artistes et habitants dans la bastide de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, ville natale d'Élisée Reclus, géographe libertaire du XIXe siècle.
Habitant-e-s de la bastide nous avons constitué un collectif pour résister à la mise à l’écart de la métropole bordelaise subie ces dernières années et nous invitons chercheurs et responsables associatifs à débattre avec nous.
En 4 jours, 40 événements se succèdent.
Conférences, concerts, pièces de théâtre, installations artistiques, apéros littéraires, films et débats rythment ce "festival de la pensée".
Nepthys Zwer
À y regarder de près, la cartographie néglige l'évocation territoriale de ceux et celles à qui on a spolié les terres. On ne parle guère des zones périphériques de ce monde. Et que dire de la vision des non-occidentaux sur cette planète ? Nepthys Zwer a coordonné et traduit l'ouvrage Ceci n'est pas un atlas, avec un autre regard sur cette terre. Bluffant.
Durant le colloque COHABITER à Sainte-Foy-la-Grande en juillet 2024, elle a animé des ateliers dans la ville sur le principe de ses cartes rebelles.
Son intervention remarquée rendant compte de ses quatre voyages en Cisjordanie donne un aperçu de l’emprise israélienne sur tous les aspects de la vie des Palestiniens : https://www.imagomundi.fr/auteur2.html
Sa contre-cartographie interroge notamment les féminismes sous le regard des Occidentaux, mâles blancs dominants : https://lundi.am/Pour-un-spatio-feminisme
Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Sociologue.
POUR LES SANS VOIX, PAUVRETÉ, MAL-LOGEMENT, INÉGALITÉS NE SONT PAS DES FATALITÉS !
Modératrice: Nadia Genêt, documentariste
Christophe Robert propose un état des lieux sans concession de cette France durement touchée et fracturée par les difficultés sociales, économiques et liées au logement. Il défend l’idée qu’il n’y a pas de fatalité et propose des solutions concrètes. Il souhaite redonner du souffle à la démocratie et stimuler les solidarités.
Christophe Clerc
La propriété a des origines bien plus anciennes qu’on ne l’imagine. Treize siècles avant notre ère, la Mésopotamie la connaissait et la codifiait bien avant les Grecs et les Romains. Aujourd’hui, il n’en existe aucune définition universelle. Chaque pays, chaque culture, chaque histoire se l’approprient. « Inviolable et sacrée » chez les Français, elle est un « faisceau de droits » pour les Anglo-Saxons, collective en Afrique, singulière en Asie… Violente par essence et pacificatrice dans l’usage, la propriété apparaît dès lors comme le meilleur outil, voire la meilleure arme pour comprendre le monde où nous sommes.
Dans Propriété. Le sujet et sa chose, Christophe Clerc et Gérard Mordillat analysent l’histoire et le concept de propriété. Un concept si familier et si énigmatique lorsqu’il s’applique à la propriété du corps, de l’intelligence, de la nature. Une chose est sûre : si la propriété a des propriétés, une grammaire, elle n’a pas de propriétaire.
Christophe Clerc est avocat à la Cour et enseigne le droit à Sciences Po.
Gérard Mordillat est écrivain et cinéaste, coauteur, entre autres, de la célèbre série Corpus Christi et de l’ouvrage Jésus contre Jésus. Après leur série Travail Salaire Profit, Gérard Mordillat et Bertrand Rothé ont publié, au Seuil, Les Lois du capital.
Cécile Asanuma-Brice, co-directrice de MITATE Lab « Post Fukushima Studies», CNRS Tokyo, autrice de Fukushima, 10 ans après. Sociologie d'un désastre [Éditions de la Maison des sciences de l'homme 2021]
https://youtu.be/PGQNY5hd2FI?feature=shared
Thierry Ribault, contre la résilience, à Fukushima et ailleurs
Dans son travail relatif à la gestion du désastre nucléaire de Fukushima,Thierry Ribault décrypte une idéologie de l’adaptation des populations et du consentement à la catastrophe et à ses suites. L’analyse critique de la politique de résilience à Fukushima est une heuristique pour comprendre comment et pourquoi les politiques publiques prétendant répondre aux désastres du techno-capitalisme – des politiques anti-covid19 aux plans d’adaptation au changement climatique – s’inscrivent dans cette nouvelle religion d’État qu’est la résilience. Il est co-auteur avec Nadine Ribault de Les Sanctuaires de l’abîme – Chronique du désastre de Fukushima, aux Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances (2012). Après dix ans d’enquête au Japon, il fait paraître Contre la résilience - À Fukushima et ailleurs, aux Éditions de L’Échappée (2021).
Funeste chimère promue au rang de technique thérapeutique face aux désastres en cours et à venir, la résilience érige leurs victimes en cogestionnaires de la dévastation. Ses prescripteurs en appellent même à une catastrophe dont les dégâts nourrissent notre aptitude à les dépasser. C’est pourquoi, désormais, dernier obstacle à l’accommodation intégrale, l’« élément humain » encombre. Tout concourt à le transformer en une matière malléable, capable de « rebondir » à chaque embûche, de faire de sa destruction une source de reconstruction et de son malheur l’origine de son bonheur, l’assujettissant ainsi à sa condition de survivant.
À la fois idéologie de l’adaptation et technologie du consentement à la réalité existante, aussi désastreuse soit-elle, la résilience constitue l’une des nombreuses impostures solutionnistes de notre époque. Cet essai, fruit d’un travail théorique et d’une enquête approfondie menés durant les dix années qui ont suivi l’accident nucléaire de Fukushima, entend prendre part à sa critique.
La résilience est despotique car elle contribue à la falsification du monde en se nourrissant d’une ignorance organisée. Elle prétend faire de la perte une voie vers de nouvelles formes de vie insufflées par la raison catastrophique. Elle relève d’un mode de gouvernement par la peur de la peur, exhortant à faire du malheur un mérite. Autant d’impasses et de dangers appelant à être, partout et toujours, intraitablement contre elle.
« Résilience non merci ! »
Recension de Contre la résilience de Thierry Ribault, et entretien avec ce dernier par Nicolas Bérard dans L'Âge de faire (n°178, novembre 2022).
Guerres, pandémies, dérèglement climatique... Face aux grandes crises, le gouvernement ne reste pas les bras croisés : il prépare des solutions qui visent moins à les éviter qu’à préparer la population à s’accommoder de ces catastrophes. Ce
« La résilience ou le consentement au désastre »
Entretien de Thierry Ribault, auteur de Contre la résilience dans La Décroissance (n°191, juillet-août 2022).
C'est devenu un mot d'ordre de notre époque, que l'on retrouve aussi bien dans des plans étatiques, des traités de collapsologie ou des guides de développement personnel : face aux crises écologique, sociale, sanitaire, économique,
-
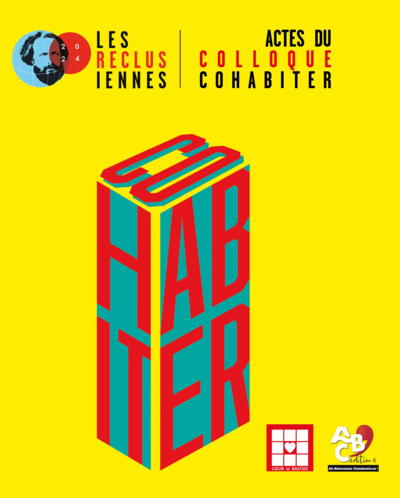 En savoir+Actes du colloque des Reclusiennes 2024Mention spéciale aux articles de Thierry Ribault (Contre la résilience), Cécile Asanuma-Brice (Quand reconstruire détruit), Nepthys Zwer (Contre-cartographie et Cisjordanie), Christine Chivallon et Chantal Crenn (Migrations)...
En savoir+Actes du colloque des Reclusiennes 2024Mention spéciale aux articles de Thierry Ribault (Contre la résilience), Cécile Asanuma-Brice (Quand reconstruire détruit), Nepthys Zwer (Contre-cartographie et Cisjordanie), Christine Chivallon et Chantal Crenn (Migrations)...








